|
|
DU 17 SEPTEMBRE AU 12 DÉCEMBRE 1944
LE FRONT DE LORIENT |
|
|
|
|
|
|
la situation |
|
les installations |
|
la position face à l'ennemi |
|
l'armement
|
|
les fusants |
|
le ravitaillement et les repas |
|
l'habillement |
|
l'hygiène |
|
les rapports avec la population |
|
le sanitaire |
|
les femmes sur le Front de Lorient |
|
plusieurs déserteurs russes dans nos rangs |
|
un déserteur autrichien dans nos rangs |
|
La situation
Lorient abritait une base de sous-marins construite à partir de l'automne 1942, complétée par une ligne de fortifications sur une longueur de 24 km, de la rivière Laïta au Pont-Lorois. Des kilomètres de fils barbelés tendus, de nombreux d'obstacles type hérisson de béton juchaient la plage, des mines avaient été posées un peu partout dans toute cette zone.
Le 1er août 1944 la 3e armée du général Patton était entrée en Bretagne en perçant le front à Avranches. Face à la progression alliée, soutenue par les résistants français, les forces allemandes s’étaient retirées vers les places fortes de Brest, de Lorient et de Saint-Nazaire. Le général Wilhelm Fahrmbacher, commandant de la forteresse de Lorient, ayant quitté son quartier général de Pontivy, s’était replié à Lorient. De là, sur les ordres d'Hitler, il s’était mis en devoir de réorganiser ses troupes.
Le 7 août 1944, près de 26000 soldats et marins allemands étaient ainsi enfermés dans le réduit lorientais. Il leur fallut ensuite miner les ponts et les itinéraires qui conduisaient vers la ville et ramener les approvisionnements des magasins des environs. Les contours de la poche étaient stabilisés le 12 août 1944. Elle s'étendait sur 50 km, de la rivière la Laïta à l'Ouest aux falaises de la rivière d'Etel à l'Est. Au-delà, les Allemands gardaient également de solides positions du sud de Belz à la presqu'île de Quiberon qu'ils occupaient en entier. La poche comprenait aussi les Ile-de-Groix et de Belle-Ile-en-Mer. Des fossés antichars et de nombreux trous individuels avaient été creusés, des abris construits, de vastes champs de mines établis. La poche à sa formation contenait plus de 45000 personnes : 20000 civils et 26000 soldats allemands.
Les mouvements de résistance se sont structurés peu à peu dans et autour de la zone assiégée. Dès la fermeture de la poche de Lorient, des Français ont passé les lignes du nouveau front pour aller rejoindre les forces françaises de l'intérieur (FFI). Dans la poche, outre des initiatives individuelles de collecte de renseignements et de sabotages, le groupe de Lorient sous l'autorité de l'officier de renseignement du 7e bataillon des FFI, Louis Helo, a joué un rôle de collecte d'informations.
Les camps se sont organisés sur un front de 90 km. Les soldats allemands, sous l'autorité du général d'artillerie Wilhelm Wilhelm Fahrmbacher, disposaient d'environ 500 canons de divers calibres dont une batterie de 203 sur l'Ile-de-Groix et des canons montés sur affûts mobiles. Les forces alliées comprenaient les 4000 hommes de la 94e division d'infanterie du général Rollins et les 12000 soldats du général Borgnis-Desbordes, nommé chef des Forces Françaises du Morbihan, qui reconstitua la 19e division d'infanterie en y intégrant les FFI.
Les duels d'artillerie étaient des types de combats récurrents. Les objectifs étaient les observatoires ennemis, notamment les clochers. Les casernements et les batteries constituaient d'autres cibles. La riposte allemande était plus nuancée, car elle était contingentée dans ses stocks de munitions. L'artillerie se déchaînait si une attaque était annoncée. La commune de Guidel était la plus bombardée de la poche. Du 29 novembre 1944 au 3 février 1945, le bourg fut encadré par des tirs d'artillerie réguliers, dans le but pour les Alliés d'abattre le clocher. Le 7 mai 1945, la commune essuya une dernière canonnade très intense. Les tirs d'artilleries s’accentuèrent jusqu'à la capitulation sans condition de la garnison allemande de Lorient. 24500 soldats du Reich étaient faits prisonniers.
Le 7 mai 1945, le cessez-le-feu fut signé à Etel. La capitulation s'effectua le 10 mai à Caudan en présence du général allemand Kramer, du général américain Rollins et du général français Borgnis-Desbordes.
Face à ces 26000 soldats allemands retranchés, des forces alliées, mais aussi des FFI venant de toute la Bretagne ainsi que du Loir-et-Cher, et issus pour la plupart des FTPF : mal armés, mal équipés, mal habillés, mal chaussés, mal logés, mal nourris, peu préparés à ce genre de combat... leur courage était à la hauteur de leurs ambitions : chasser l'occupant et en terminer avec cette sale guerre… Pour ma part, ça faisait presque neuf ans que je n'avais pas connu une vie normale. |
Les installations
Nous nous sommes installés dans les champs et les prairies, là ou la place convenait. Nous avions à surveiller une bande de 400m de longueur environ, allant de la gauche de la ferme de Penhoët jusqu'à 200m ou 300m de Sainte-Hélène, derrière nous la route, au delà la rivière d'Etel.
Des baraques avaient été fabriquées par d'autres qui occupaient le terrain avant notre arrivée et que nous venions relever : c'était le groupe d'Hector de Jugon-les-Lacs. Ces baraques étaient faites de terre et de branchages. Quelques améliorations furent apportées pour les rendre plus confortables. Nous dormions à dix par baraque à même la terre sur de la paille que nous réquisitionnions chez les paysans. |
La position face à l'ennemi
Il n'était pas besoin d'être grand stratège pour se rendre compte que notre position en ligne était illogique, aberrante et dangereuse. Nous étions coincés dans un cul de sac entre les lignes ennemies et la rivière d'Etel, sans possibilité de repli. Hector, fut condamné aux arrêts de rigueur pour avoir refusé d'occuper une position qu'il jugeait dangereuse, le dos à la rivière n'offrant aucune possibilité de repli. Le général de-Larminat, commandant des forces de l'Atlantique, voulait que nous abandonnions cette tête de pont, mais le commandant FFI Jean Le Coutaller, un socialiste, disait : "Ceux qui ne veulent pas rester là n’ont qu'à rentrer chez eux". Quel mépris ! C'était un incapable, mais nous nous sommes souvent demandés si ce n'était pas une stratégie pour nous éliminer, nous qui étions presque tous issu des FTPF. |
L'armement
La principale arme en notre possession était la mitraillette anglaise Sten, provenant des parachutages du 3 mars et de fin juin 1944, de fabrication rudimentaire, de mauvaise qualité : ossature en tôle d'acier pliée, très sensible aux chocs, le fait de la poser un peu brutalement au sol sur la crosse pouvait provoquer son déclenchement, le percuteur étant assez lourd, lors d'un choc celui-ci pouvait rebondir et percuter le culot d'une balle, plusieurs accidents mortels furent à déplorer, elle n'avait aucune précision ne permettant de tirer qu'au jugé en balayant un angle.
J'ai voulu mettre en garde certains de mes camarades sur les dangers dans la manipulation de ces mitraillettes anglaises, l'un d'eux ne pensant pas que ces armes étaient aussi dangereuses dans leurs maniements posa un peu trop brutalement son arme, la crosse frappant le sol, une balle partie et me passa au raz de la tête.
Nous étions sous équipés en armes et en munitions, de plus le peu que nous avions en notre possession étaient inadaptées.
Devant cette situation, vers le 15 octobre 1944 je suis venu dans le secteur de Lannion avec des camarades pour récupérer des armes et munitions de toutes sortes, anglaises (des restes de celles qui nous avaient été parachutées) et allemandes (prises sur l'ennemi lors de la reddition, en particulier des fusils Mauser, arme efficace et précise), pour les transporter nous avons réquisitionné un camion Citroën de 5 tonnes à l'entreprise Vallée fabricant de papier de Belle-Isle-en-Terre. Par la même occasion nous avons complété le chargement par de la nourriture collectée auprès de la population car sur le Front de Lorient il était difficile de se procurer de la nourriture étant donné que la plupart des exploitations agricoles nous entourant avaient été désertées par leurs occupants par crainte des bombardements et des tirs d'artillerie de l'armée allemande. Le camion fut ensuite restitué à son propriétaire. |
Les fusants
Les fusants étaient très redoutés. Il y en avait de deux sortes :
- obus fusants au bruit caractéristique éclatant à une certaine distance au dessus du sol coupant les branchages des arbres et libérant une multitude d'éclats métallique en fonte, causant beaucoup de dégâts, cisaillants les petits branchages des arbres et causant des blessures et la mort.
- obus percutants éclatant en touchant le sol y creusant un cratère.
Ces engins de morts firent de nombreuses victimes parmi nous. |
Le ravitaillement et les repas
La viande, les légumes et le vin étaient fournis par l'intendance. Les pommes de terre et le cidre étaient réquisitionnés dans les fermes. Lorsque je prenais possession des denrées, je laissais au cultivateur une facture qui m'était délivrée par l'intendance. Le paysan la signait après avoir reçu l'argent liquide.
Les paysans qui avaient des surplus de denrées étaient contents de nous les vendre ; par contre ceux qui étaient un peu juste râlaient.
Les repas étaient cuits et pris en plein air dans des marmites de récupération.
Louis Lalès et Denis Traourouder, boulanger à Belle-Isle-Bégard, sont venus de Louargat nous apporter de la nourriture en octobre ou novembre 1944. Ils sont restés très peu de temps. |
L'habillement
Nous sommes arrivés sur le front au mois de septembre pour certains en sabots et en bras de chemise à une saison ou les nuits ne sont pas encore trop froides, mais très rapidement le temps s'est gâté, les nuits sont devenues plus froides, l'humidité envahissait les campements, la neige a fait son apparition et les équipements promis tardaient à arriver. Nous manquions cruellement de chaussures adaptées.
La veille de l'attaque du 28 octobre 1944, devant la manque criant d'habillement, en particulier de chaussures, je suis allé avec Job Le Meur voir le général Borgnis-Desbordes à son PC. Le général Borgnis-Desbordes avait été sanctionné lors du débarquement en Provence pour avoir refusé d'exécuter des ordres par rapport au manque de moyens mis à sa disposition. On ne pouvait pas le rencontrer facilement dans son PC qui était d'ailleurs un moulin, il fallait au préalable passer dans un bureau dans lequel il y avait 3 colonels auxquels nous devions expliquer nos motivations. Finalement nous l'avons rencontré et obtenu satisfaction pour obtenir des chaussures.
Notre bataillon a été pourvu de tenues très tardivement : au printemps 1945 !
Cette tenue comprenait :
- une chemise et une cravate,
- un pantalon avec ceinturon,
- une paire de rangers,
- un calot,
Nous avons dû acheter le linge de corps. |
 Septembre / octobre 1944, sur le Front de Lorient, de gauche à droite, debout : Yves Ollivier, Armand Tilly, Emile Charles, Elysée Tilly, André Lamouler, Jean Le Gars, Marcel Le Moal, Raymond Féjean, Paul Le Bolloch, Eugène Le Lagadec. Assis : Emile Brizaut, Eugène Artur, Félix Lorou, Yves Minoux et Louis Torquéau.
Septembre / octobre 1944, sur le Front de Lorient, de gauche à droite, debout : Yves Ollivier, Armand Tilly, Emile Charles, Elysée Tilly, André Lamouler, Jean Le Gars, Marcel Le Moal, Raymond Féjean, Paul Le Bolloch, Eugène Le Lagadec. Assis : Emile Brizaut, Eugène Artur, Félix Lorou, Yves Minoux et Louis Torquéau.
On remarque les tenues hétéroclites, des soldats sans uniforme. |
L'hygiène
Tout se passait en plein air, pas d'eau chaude, pas de douche. Ces conditions sanitaires exécrables ont généré pour beaucoup des maladies de peau comme la gale. |
Les rapports avec la population
Par mesure de sécurité la population vivant à proximité des lignes avait été évacuée, les seuls rapports que nous ayons étaient avec les paysans pour le ravitaillement. |
Le service sanitaire
Chaque compagnie avait sa propre infirmerie fonctionnant avec peu de moyens, c'est Joséphine Tilly "Fifine" et Yvonne Cadran qui en étaient les responsables. Nos braves infirmières eurent à soigner des blessures mais aussi des maladies dues au manque d'hygiène et encore tenter de réconforter certains de nos camarades. |
Les femmes sur le front de Lorient
Les femmes avaient un rôle très important ; elles étaient attachées au service sanitaire, soignant les petits "bobos" mais aussi relevant le moral ; d'autres étaient affectées au secrétariat et à l'intendance des Etats-Majors des unités combattantes.
Celles que j'ai plus particulièrement connues :
- Joséphine Tilly, née le 18 juin 1921 à Bégard, dont la mère Alexandrine née Le Guyader mourue dans le camp de concentration de Mauthausen (Autriche), elle avait la responsabilité du service sanitaire, elle épousa Pierre Le Manac'h qui fut codamné à la peine de mort par un tribunal Militaire allemand puis interné à Karlsruhe en Allemagne.
- Angèle Le Vézu, née le 23 avril 1912 à Louargat, qui faisait la liaison entre les compagnies. Le 27 octobre 1944 nous subimes la violente attaque allemande, nous étant disputés et sous un déluge de feu elle refusa de se mettre à l'abri,
- Marie, Louise Moulin épouse Pellicier, née le 29 mars 1901 à Paris 2e, au moment de franchir la rivière elle fut tuée par un éclat d'obus lors des combats de Sainte-Hélène le 27 octobre 1944 (une plaque à sa mémoire a été mise en place en 2003 au monument aux morts de cette commune),
- Yvonne, Marie Cadran, né le 7 février 1920 à Trédrez-Loquémeau, adoptée par la Nation, épousa le 17 février 1945 à Trédrez notre camarade Clet Moguen.
- Mademoiselle Bernard de Trédrez-Locquémeau, elle resta volontairement à l'infirmerie de Sainte-Hélène auprès des blessés intransportables ; elle subit le même sort que les hommes prisonniers des Allemands à l'Ile-de-Groix.
- Hélène Thoraval.
|
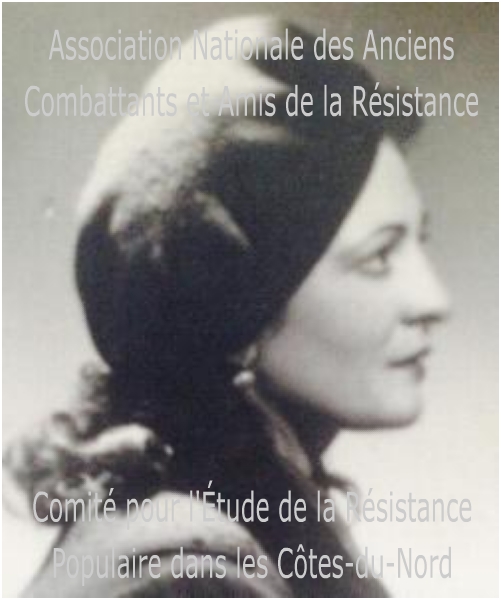
Joséphine Tilly |
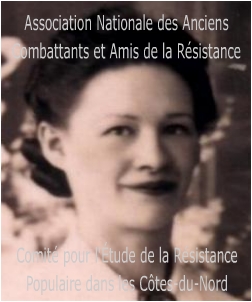 Angèle Le Vézu |
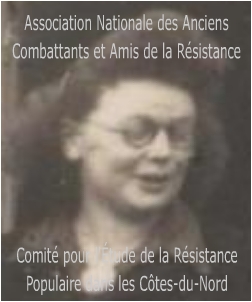
Hélène Thoraval |
|
Plusieurs déserteurs russes dans nos rangs
Le lieutenant russe Nicolas Grinine avait été enrôlé de force dans l'armée allemande. Il travaillait au service géographique de l'armée rouge et était originaire de Léningrad, demeurant sur la Fontanka, une rue perpendiculaire à l'Étna où je suis passé lors d'un voyage en URSS dans les années 1980. Il était affecté à la défense des côtes aux environs de Paimpol.
Fin juillet début août 1944, il a, en compagnie de plusieurs compatriotes, faussé compagnie à l'ennemi, emportant avec lui des armes dont 2 attelages tractés par des petits chevaux tirant 2 canons de 47 mm, pour rejoindre la résistance FTPF. Cet équipement fut emporté avec eux sur le Front de Lorient. Lors de l'attaque ennemi du 27 octobre 1944, contre nos lignes entre Nostang et Sainte-Hélène, avec les 2 canons tractés par les attelages, se déplaçant, ils ont harcelé l'ennemi tout le long de nos lignes, faisant croire que nous disposions de plusieurs pièces d'artillerie.
C'est là que je l'ai connu et quitté le 29 octobre 1944. Après guerre nous avons correspondu quelques temps. |
Un déserteur autrichien dans nos rangs
Un Autrichien, Franz Petrei, avait déserté la base d'aviation de Servel près de Lannion avec armes et bagages, le 25 mai 1944, pour rejoindre la résistance FTPF. il participa à plusieurs actions sous le commandement de Corentin André, le capitaine Maurice, jusqu'à la Libération du secteur Lannion - Perros-Guirec - Tréguier. Blessé en octobre 1944, il revint, une fois guéri, rejoindre ses camarades.
Il avait impressionné son entourage par la précision de ses tirs, utilisant son Mauser qu'il avait emporté avec lui lors de sa désertion. |
|
|